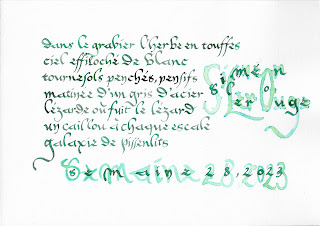Au tout début, je courais d’un buisson à l’autre au milieu des forêts. Une traînée d’empreintes entre les herbes, toujours fourrée sous les pattes des animaux sauvages. Je passais et repassais dans la broussaille à grands coups de cavalcades et de petits sauts, j’étais pareille à la mue que les serpents laissent derrière eux : longue, ondulée. Seules les allées et venues me donnaient un peu d’allure. Plus on m’empruntait, plus mon caractère se forgeait. Sans corps, sans tête, j’étais ce creux dans le paysage, une rigole de pierres plates et de terre.
À cette époque, j’étais si tendre qu’un rien marquait ma mémoire d’argile mais, rapidement, les quelques mètres d’herbe foulée ne me suffirent plus. Je pris goût aux voyages. Lors des transhumances, je me donnais l’air de savoir où j’allais en suivant les troupeaux. Fuyant soit la glace, soit le trop chaud. Pareille aux bêtes, j’étais farouche, toujours sur mes gardes, ma glaise collant à leurs sabots. Le reste du temps, je prenais ma source depuis un terrier, coulais le long d’un val à sec et venais mourir tout en haut d’un col, où paissaient les grands herbivores. Je tenais ferme au passage de la faune. Quand les ruminants allaient boire, j’encerclais les mares et les étangs. Il m’arrivait aussi de renaître ailleurs, là où les prédateurs rôdaient avant de partir en chasse.
Il n’y avait alors ni champs, ni clôtures. L’homme descendait à peine des arbres. Ses premiers pas se mêlaient à ceux des grands singes. Nous ne nous étions pas encore croisés. Il apprenait tout juste à marcher que je caracolais déjà dans les bois. Il a fallu qu’il poursuive mes troupeaux pour qu’on noue connaissance. Ses pieds me dessinèrent en écrasant les herbes hautes. Plus il passait, plus j’apparaissais, couverte de terre et bosselée. En échange, je modelais sa voûte plantaire aux gros cailloux de mes vertèbres. J’aimais ses pieds couverts de corne et sa démarche de bipède. Bientôt, il allait devenir mon seul compagnon. Il avait de la distinction. Son sens raisonné de l’orientation me subjuguait. Lui seul enfilait des chaussons de fourrure pour parcourir des distances incroyables. J’étais sous son charme.
Nous cheminions de plus en plus loin et contrairement à tous les autres animaux, l’homme ne laissait jamais les mêmes traces. Il aimait beaucoup me surprendre. Ses empreintes cédèrent le pas aux lignes parallèles et continues qui allaient décider de toute ma vie : il avait inventé la roue. Elle allait creuser le sillon de mes premières ornières. Je n’en revenais pas. Une nouvelle vie commençait.
Nous faisions tout ensemble. Il avait l’art du raccourci, sculptant le paysage par d’adroites lignes géométriques. J’aimais ça. Il était aventureux, rien ne l’arrêtait, des déserts du sud aux neiges du nord, il me faisait voyager. Je le suivais partout, je m’effaçais derrière lui, nous luttions tous les deux pour ne pas disparaître dans les grands espaces. Je m’accrochais ventre à terre aux sols les plus hostiles. L’hiver, même sous la neige, je n’hibernais plus. Je me couvrais d’un pelage de boue gelée jusqu’au printemps. À la belle saison, je ne m’enherbais plus. Quand il faisait soleil, je laissais dorer les cailloux ronds de ma peau.
Bientôt, je me couvris de pavés. L’homme avait besoin de moi pour édifier ses villes et ses villages. Je devais les relier. Pour ça, il voulait que je sois forte et courageuse. Une fois mon tracé bien en place, j’accompagnais les hommes au quotidien. On immortalisa mes sauts au-dessus des fleuves par des ponts de bois, puis de pierre. Les animaux sauvages m’évitaient, ou passaient rapidement sur mon dos pelé. En coupant la nature à grands traits, je me coupais d’elle. Nous n’avions plus rien à nous dire. Je n’avais pas été la seule à suivre aveuglément les hommes. Les chevaux, les bœufs et tant d’autres s’étaient rangés de leur côté. Nous ne pouvions pas rester éternellement dans les bois, à suivre le mouvement hasardeux des hordes sauvages.
Je faisais des progrès. Comme j’avais bonne mémoire, j’étais de bon conseil : on finissait toujours par revenir sur mes pas. Au début, l’homme savait dans quelle direction aller, je le suivais comme son ombre. Les rôles se sont inversés, il a fini par me suivre sans se poser de question. Quand il faisait la guerre, je m’agrandissais pour laisser passer ses troupes et ses engins. Je ne prenais pas parti, mon tracé servait les deux camps. Je rayonnais, passant sur des aqueducs, traversant toute l’Europe et au-delà. On me fit même des bornes et des relais de poste. On décréta que j’étais commerciale à tel endroit, à tel autre sacrée ou royale, cela dépendait des peuples et du cours de l’Histoire.
L’homme fit mon portrait sur d’immenses cartes. Les traits fins de mon visage occupaient tout le territoire. Mon regard pétillait dans les villes que je cerclais de noir. Dans des drapés de champs et de collines, j’étais resplendissante. Sur les tables d’état-major, on me montrait du doigt en rêvant de conquêtes.
En même temps que mon corps s’aplanissait pour porter sans cahots calèches et carrosses, on me recouvrit de gros pavés de grès bien fort, de pierraille et de sable doux. On prenait goût au confort et aux commodités du voyage. Mais je restais aventureuse : à mon corps défendant, bandits et pillards pullulaient sur le bas-côté. J’avais du caractère, beaucoup de montées, de descentes et de virages en épingle. Si j’aimais parfois laisser flotter ma traîne de poussière derrière la charrette d’un paysan, j’aimais aussi faire battre mon cœur au trot continu des cavaliers. La vitesse me gagnait. D’un côté, je menais avec lenteur les pèlerins à destination ; d’un autre, j’excitais les diligences qui passaient en trombe. Je n’aimais rien tant que le bruit des essieux de bois, le galop et la bride abattue.
Comme dans toutes les grandes civilisations, on m’apprit l’hygiène et la propreté. Je m’entourais de caniveaux, d’égouts et de trottoirs bien nets. Les jours de forte pluie, je prenais figure humaine en reflétant dans les flaques le reflet des hommes et de leurs engins. Des engins de plus en plus lourds, de plus en plus rapides. Je trouvais cela grisant. Ma vie prenait un tournant. Pour rien au monde je n’aurais changé de voie. Dans la terre de mes remblais, mes états d’âmes se mêlaient à la voirie des premières canalisations. Mes veines charriaient les eaux usées.
À force de rivaliser avec les cours d’eau, les rivières et les fleuves, je devins rapidement plus grande que ces chemins qui marchent tout seuls. Ma victoire signa la fin du transport fluvial : la plupart des bateaux se changèrent en voiture. J’entrais dans les villes en tenant le haut du pavé.
Il y eut des guerres, et d’autres guerres encore. À chaque combat je me multipliais, passant dans le moindre village, le plus petit hameau. J’étais essentielle aux manœuvres des hommes. Pour eux, on peut dire que j’ai mordu la poussière. Comme un soldat, on me décora de médailles, on baptisa mes tronçons du nom de leurs batailles, on fit courir des rubans de pierre sur ma poitrine.
J’étais tout pour lui, mais l’homme me fut infidèle. Un autre chemin, celui-là de fer, allait me doubler. Depuis ses rails où circulaient des wagons, qu’il baptisa « voiture » pour me narguer, il me poussa sur le côté, derrière ses hauts talus. On se partagea à l’amiable le territoire : je desservais ses gares, il me désengorgeait. J’étais à cette époque en pleine réfection. Je devais à tout prix me réinventer pour rester dans la course. En grisonnant, j’allais prendre de la vitesse. Les générations de cantonniers qui s’étaient occupées de moi, me remblayant, me déblayant, furent peu à peu remplacées par des excavatrices, des bétonnières, des niveleuses, des rouleaux compresseurs et des goudronneuses. Les balayeurs devinrent des balayeuses.
Je tressais aux abords des grandes villes des échangeurs qui allaient toujours par quatre chemins. Ma vie allait en se ramifiant. J’arrondissais les angles en de beaux virages et, même comprimée sous l’asphalte, je bombais fièrement le torse pour faire ruisseler l’eau des pluies. J’étais, vue du ciel, les veines bleu-pétrole du monde. J’avais transformé tous les paysages, coupant les forêts, sautant les fleuves et les rivières, serpentant sur les montagnes avant de les percer par d’immenses tunnels. Mon réseau d’artères alimentait le cœur des mégapoles. Même les déserts se peuplaient sur mon passage. J’enserrais l’univers de mes tentacules rigides. Je le tenais dans ma main. Je n’étais rien sans les hommes, je voulais croire que la réciproque était vraie. Et je me trompais.
Les marquages au sol et les lignes blanches furent les premiers signes de ma vieillesse. La prudence devint ma nouvelle obsession. Forte de siècles d’expérience, j’allais dispenser ma sagesse aux hommes. L’âge venant, je ne supportais plus la vision de la mort. Il me fallait avancer prudemment, d’un avertisseur à l’autre. Les véhicules me faisaient peur. Je les freinais, redoutant qu’ils n’aillent me casser quelque chose. Ils étaient de plus en plus nombreux et turbulents. Comme autant de rides, d’autres voies, minces et nombreuses, sillonnaient mon corps. J’avais beau multiplier les lignes de dissuasion et les garde-fous, les voitures allaient encore trop vite à mon goût. Si vite que je les sentais à peine passer sur mon dos, comme un frisson. Elles dépassaient les bornes. J’avais toujours, heureusement, des centaines de kilomètres d’avance sur elles.
D’habitude sage et immobile, j’allais me cabrer. Je ne supportais plus ma vie qui devenait franchement routinière. Je n’avançais plus. On rechignait même à me maintenir en état : je coûtais trop cher. C’en était trop. Les hommes avaient les yeux ailleurs. Ils finirent par préférer d’autres canaux, plus jeunes et plus beaux. Ces voies-là avaient l’avantage d’être invisibles. Il y avait celles de l’air et de l’espace que j’avais déjà rencontrées, mais une nouvelle vint au monde : celle de l’informatique. Elle ne cessait de s’améliorer, passant à la fois dans le sol, sur la terre, sous la mer et dans les airs. Virtuelle, omniprésente, instantanée, elle avait maintenant toute l’attention des hommes. J’eus bientôt honte de mes proportions grossières, trop larges et maladroites. Face à ce nouveau flux de la taille d’un cheveu, mais fort et abondant comme un torrent, je ne pouvais plus résister. Il devint à son tour une route aux circulations incessantes et simultanées. Je n’avais plus la force d’autrefois pour me rebeller, je ne parvins qu’à me crisper dans les centres-villes où mon front se couvrait de dos d’âne. Incapable de me dominer, je finissais par bouchonner aux heures de pointe. J’étais inconstante et hypocondriaque, me mettant en travaux pour un rien. À d’innombrables feux tricolores, je reprenais mon souffle.
Pour assurer ma fin de vie, je devins pingre et fis monnayer le moindre de mes services. Les hommes allaient devoir payer pour circuler, pour stationner, pour tout. Je ne me laissais pas faire. Je n’avais plus peur de tourner chèvre dans d’impossibles ronds-points. Pour la première fois de ma vie, il m’arrivait de me perdre dans mes propres labyrinthes de voies sans issue et de sens interdits.
Voilà que depuis quelques jours c’est la panne sèche. L’homme et moi, comme un vieux couple, nous n’avons plus d’énergie. Tous deux épuisés, sans ressources. Plus rien ne roule. Mes stations sont hors service. On ne m’emprunte plus. Je me sens abandonnée. Quelques camions passent encore sur le dos de ma main tremblotante, et de temps à autres des voitures, de plus en plus rares, silencieuses et discrètes. Je n’ai plus l’ouïe aussi fine qu’avant depuis que mes bandes d’alertes sonores ont disparu, mais cela fait bien longtemps que je n’ai plus entendu un klaxon. Ma vue baisse, mes radars sont aveugles. Certaines frontières sont bouchées. Je ne vois plus au-delà. Je me barricade, j’installe des barrages et des douanes un peu partout. Comme je ne vais plus aussi loin qu’avant, je me contente des ragots entendus lors des contrôles routiers. Je passe le plus clair de mon temps sur des aires de repos où, pour m’occuper, j’élève des nids de poule. Quand ça ne va vraiment plus, je me recroqueville sur une zone d’arrêt d’urgence.
Quelle déroute. Dans les déserts, mes souvenirs s’ensablent. Mes artères se bouchent dans les forêts et, sur les montagnes, je m’essouffle. Je vais dans tous les sens, coupée à gauche et à droite par la végétation. Je me sens retomber à l’état de nature, vivotant dans les villes où on m’emprunte encore un peu. J’assiste impuissante aux râles des moteurs en fin de vie, au dernier souffle des pots d’échappements.
Heureusement, je reçois la visite de ma progéniture, ces petits chemins qui me soutiennent dans mes derniers mètres.
Sans eux, j’irais dans le décor.
Bien plus humbles que moi, je les vois guider des mulots, des fourmis et des crapauds.
Ils sont nés de mes lézardes, je me suis décidée à leur céder le passage.
Qu’ils aillent, à leur tour, loin des sentiers battus.